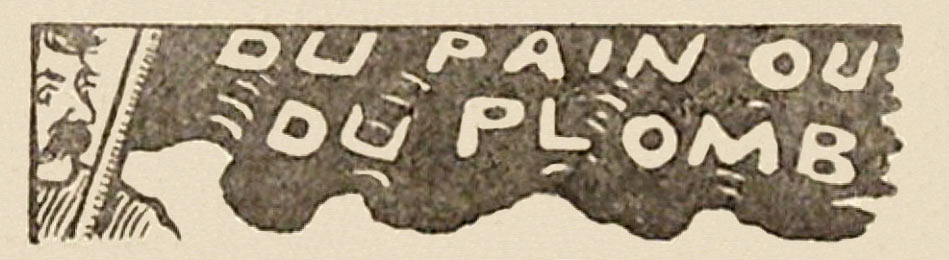On s’est plaint maintes fois, pas les anarchistes qui courent, de manquer de police. On a eu tort. La police nous fait si peu défaut, qu’au lieu d’une nous en avons deux. Il y a d’abord celle du préfet. Il y a ensuite celle du directeur de la Sûreté générale. Il y en a même une troisième, la police du Cabinet attachée plus particulièrement à la personne du ministre. Mais celle-ci, composée de décavés, de rastaquouères et de pseudo-journalistes, toujours brûlés et toujours les mêmes, ne sert guère qu’à exploiter les ministres lorsqu’ils arrivent et à les faire chanter quand ils sont partis. Autant dire que ses services sont des plus relatifs. La police politique — c’est de celle-là seulement que je veux parler — ne se fait de façon-vraiment utile que dans les bureaux du boulevard du Palais ou dans ceux de la rue Cambacérès. Sur l’utilité de ce genre de police, il n’y a plus guère à discuter aujourd’hui ; les arguments qui lui furent opposés au moment où fut supprimée la brigade Lombard ne tiendraient pas debout devant l’existence du parti anarchiste et ses moyens d’action. Ce qui est plus discutable, c’est la manière dont cette police est organisée.
On a cru longtemps que c’était pour le ministre une excellente chose de pouvoir se renseigner à des sources différentes et contrôler ainsi ses informations les unes par les autres. En principe la méthode est séduisante. En réalité elle aboutit à un perpétuel conflit. La juridiction de la Préfecture embrasse le territoire de la Seine ; celle de la Sûreté générale ne devrait s’exercer qu’en province, et pourtant de cette dernière relèvent trois commissaires spéciaux qui, détachés rue Cambacérès, n’ont pas d’autre mission que de faire à Paris même, de « l’information politique ». Ce sont MM. Paoli; Escourrou et Dietz, et chaque fois qu’il s’agit d’élucider une affaire intéressant la sûreté de l’Etat, ces messieurs opèrent parallèlement aux trois officiers de paix du «service des recherches », MM. Auger, Fédée et Boys, qui eux travaillent pour le compte de la Préfecture.
On devine bien que ce parallélisme, s’il présente quelques avantages, ne va pas sans beaucoup d’inconvénients. Le premier consiste en des brimades réciproques qui rappellent la légendaire rivalité, sous l’Empire, d’Hyrvoix et de Lagrange, et le plaisant antagonisme qui régnait alors entre la police du «Château » et celle de la «Maison ». Le Château, aujourd’hui, c’est le ministère de l’intérieur ; la Maison, c’est toujours la maison qui est au coin du quai. Deux exemples entre mille donneront une idée de cet état de choses. Le premier remonte aux temps du boulangisme. Un jour, le bruit vint à courir que le général, se disposait à quitter Regent Street. M. Constans, désirant être, à cet égard, très exactement renseigné, pria M. Lozé et M. Gazelles de faire, chacun de son côté, le nécessaire. M. Lozé avait à Londres des agents à demeure, M. Cazelles envoya un de ses commissaires spéciaux.
Il s’agissait entre la Maison et le Château de savoir qui arriverait bon premier. Ce fut l’envoyé de M. Cazelles qui l’emporta. Se donnant comme un marchand d’éventails, il pénétra chez le général, lui causa et s’assura ainsi de sa présence. A l’instant même où il sortait, il croisa devant la porte les agents de la préfecture qui faisaient « une plante». Une idée amusante lui traversa l’esprit. A peine eut-il fait quelques pas, qu’il dépêcha sur les lieux ses propres agents avec ordre de dévisager sous le nez leurs camarades de la Préfecture. Ces derniers, se croyant dépistés, battirent en retraite, remettant au lendemain la suite de « leur plante », et notre Spécial repartit le soir même, muni de son Renseignement que seul il possédait. Il ne faudrait pourtant pas de cette anecdote conclure que les agents de la place Beauvau ont la spécialité de ces taquineries entre collègues. Les gens de la « Maison » les leur rendent avec usure. Nous venons d’en avoir une preuve toute récente dans l’affaire des anarchistes.
La veille de l’explosion du restaurant Véry, M.Dietz avait reçu un « petit bleu » l’informant qu’on devait le lendemain faire travailler la dynamite. Chez un magistrat, probablement, ajoutait le télégramme. Il était évident, à première lecture, que «l’indicateur » avait saisi quelques propos, qu’il s’était empressé, comme il arrive souvent, de le télégraphier sans plus de précision, mais telle quelle l’indication méritait qu’on en tînt compte. M. Dietz dépêcha aussitôt un commissaire adjoint, M. Martin, à la place Beauvau, et le ministre de téléphoner bien vite à son préfet de police. « Nous avons, nous aussi, nos informations; laissez-nous faire. » Telle fut, textuellement, la réponse qui vint de la Maison. Le lendemain, Véry sautait.
Quelques jours plus tard, sur une piste fournie par M. Dietz, Francis était arrêté. Pour demander cette arrestation, M. Dietz avait quelques motifs plausibles ; c’étaient les révélations d’un compagnon, grand ami de Francis, mais dévoué à M. Dietz, et que M. Dietz, détail comique, fait régulièrement incarcérer à chaque rafle d’anarchistes. Francis invoqua un alibi. Le Parquet y crut, mais M. Dietz, lui, savait de bonne source comment s’y prennent tes anarchistes pour se ménager d’avance des alibis prudents.
Ils sont 200 environ, appartenant tous au groupe de la « Propagande Anarchiste », qui fréquentent assidûment deux débits; l’un situé rue Oberkampf et l’autre rue Aumaire, ou qui, le plus souvent, se réunissent dans un établissement nommé « les Grandes Caves ». C’est là que les anarchistes, discutent et dressent leurs plans ; c’est là que venait Francis, et c’est dans ce milieu qu’il s’était d’avance assuré des témoignages pour son alibi. M. Dietz le savait pertinemment. Il insista donc auprès de la Préfecture pour que Francis fût l’objet d’une « filature » des plus sévères, même après avoir été relâché comme innocent.
Mais la « Maison » ne crut pas devoir tenir autrement compte des conseils du «Château», et Francis est aujourd’hui à Londres, d’où il fait la nique aux deux polices réunies.
Ces brimades ne sont pas, d’ailleurs, le seul inconvénient de l’antagonisme qui existe entre la Maison et le Château. Il est d’autres inconvénients qui résultent de l’organisation actuelle. Les officiers de paix comme MM. Fédée, Auger et Boys ont tous pouvoirs pour faire à la fois « l’information » et « l’exécution ». Les Spéciaux, eux, doivent se contenter, à Paris, de faire de « l’information », et dès qu’il s’agit : d’exécuter, les voilà obligés de passer la main à la Préfecture. On entend bien que cela ne fait pas tout à fait l’affaire, et que, bons chiens de chasse, les Spéciaux ne se soucient pas toujours de lever le gibier pour le rabattre sur la «Maison ».
De là un certain découragement chez les Spéciaux, une certaine inertie dédaigneuse chez les agents de la Préfecture, et, en fin de compte, des tiraillements préjudiciables au service.
Il semble, au premier abord, qu’il serait facile d’y remédier. Rien ne paraît plus simple que de laisser à la seule Préfecture le soin de faire toutes les recherches, puisque seule la Préfecture est complètement armée pour cette chasse. Rien ne paraît plus aisé que de supprimer la police du Château pour se contenter de celle de la Préfecture.
Le raisonnement serait juste, si la Préfecture, à son outillage, joignait toutes les aptitudes qu’exige la police politique. Mais il s’en faut qu’il en soit ainsi.
La Préfecture, par l’étendue de ses attributions est tenue d’avoir l’œil sur tout. Qui trop embrasse, mal étreint. MM. Auger, Fédée et Boys ne sont pas seulement chargés des recherches politiques, ils sont chargés aussi de recherches de tout ordre. Dès lors, ce n’est pas seulement par l’effet d’une trop grande extension que leurs services s’affaiblissent ; c’est surtout parce que ces agents sont employés le plus souvent à la recherche des délits et des crimes, et qu’à ce métier ils acquièrent une psychologie criminelle et non une psychologie politique. Ce n’est pas du tout la même chose. On s’en aperçoit de reste quand ces messieurs opèrent sur le terrain politique.
Lorsqu’il y a deux mois, après la grande rafle qui venait d’être faite, on crut pouvoir relâcher un certain nombre d’anarchistes, ce fut sous condition qu’ils se feraient, le cas échéant, les collaborateurs de la Préfecture. Tous promirent, bien entendu ; aucun pourtant n’a tenu sa promesse. La Préfecture avait espéré que les choses se passeraient comme avec les « chevaux de retour », dont la seule idée est de se garer de la justice ; elle avait compté, avec les anarchistes, sans la dose de conviction qui se retrouve plus ou moins chez tous les révolutionnaires.
La Préfecture, il est vrai, a sur la Sûreté générale l’avantage de recruter plus facilement des auxiliaires dans tous les mondes. Dans le monde des garnis, des mastroquets, des pickpockets, des souteneurs et des filles, les collaborateurs s’offrent d’eux-mêmes à la police parisienne, mais rien n’indique que ces collaborateurs soient aptes plus spécialement à la police politique. Or le nombre des indicateurs, en cette matière, importe peu: ce qui importe,c’est leur qualité et, sur ce point, la supériorité de la Préfecture n’est qu’apparente.
Tout autre en effet est la façon de procéder à la Sûreté générale. D’abord les commissaires spéciaux chargés de faire de la police politique n’ont pas autre chose à faire que cette police-là; ils y peuvent appliquer toute leur attention. Ce n’est pas un mince avantage si l’on songe que toute question de police est comme un problème d’échecs, qu’il faut s’y absorber tout entier, calculant chaque coup, préparant l’un par l’autre. D’autre part, les commissaires spéciaux n’ont sans doute pas à leur disposition des indicateurs tout faits. Mais loin que ceci soit un mal, il paraît bien, à la réflexion,que c’est une bonne chose. Les commissaires spéciaux sont en effet obligés, pour chaque circonstance, de se ménager des intelligences « particulières » et se «créer »,pour chaque occasion, l’indicateur voulu.
On voit que ce dernier système n’est pas sans quelques avantages sur le système en usage à la Préfecture. C’est d’ailleurs à la pratique et aux résultats qu’il faut en demander la preuve. Pour quiconque connaît les dessous de la période boulangiste, durant laquelle la police joua un si grand rôle, les gaffes de la Préfecture se comptent par centaines. Connaît-on par exemple la piteuse mésaventure de ce « fileur » resté en panne devant le restaurant Lucas, tan dis que le brav’ général traversait le passage et allait prendre, de l’autre côté, le fiacre qui devait le conduire à la gare du Nord? Toutes les recherches de la Préfecture, à cette époque, furent du même acabit. Plus heureuse fut la Sûreté générale, et M. Constans vous racontera qu’un de ses commissaires spéciaux, grâce à l’intermédiaire d’un détective londonien et à la complaisance inconsciente d’un valet de chambre, lui remettait quotidiennement les feuillets d’une autobiographie, écrite au jour le jour, par le général lui-même. En matière de police, c’est là un assez joli tour de force.
Pour revenir aux anarchistes, la comparaison entre la Maison et le Château , ne tournerait pas davantage à l’honneur de la Préfecture. On connaît mal l’équipée des deux policiers récemment envoyés à Londres à la poursuite de Francis. On n’ignore peut-être pas que la nouvelle de leur départ avait été communiquée par la Préfecture elle-même à un journal du matin, et que cette nouvelle, téléphonée instantanément à Londres par l’Agence Dalziel, avait eu pour effet de donner l’éveil aux anarchistes. Ce qu’on ignore davantage, c’est la façon dont M. Houillier, arrivé à Londres, orienta ses recherches.
A dire vrai, le choix de cet inspecteur n’était pas des plus heureux. Déjà, quelque temps auparavant, M. Houillier avait été lancé en Angleterre sur les traces de Mathieu. Arrivé à Londres, M. Houillier avait réussi à pénétrer dans les milieux anarchistes. Jusque-là, c’était à merveille. Mais où M. Houillier fut un peu moins habile, c’est lorsqu’il déclara à ses nouveaux amis qu’il recherchait « dans son intérêt» l’introuvable compagnon. La confidence était naïve. Pour toute réponse, elle valut à M. Houillier la menace de « lui casser les tibias » à la première occasion.
M. Houillier était donc « brûlé » d’avance, lorsqu’il est retourné l’autre semaine à Londres. D’autre part, il avait cru bien faire en s’assurant le concours d’un détective anglais, Heindrich, qu’il avait connu à Paris. On sait qu’avec le système de primes en usage chez nos voisins, les détectives prennent à forfait les recherches criminelles et que chacun d’eux peut être demain appelé à opérer dans le rayon de Paris. La police française est donc assurée de trouver chez eux toutes sortes de complaisances. Le détective de M. Houillier était si complaisant que d’abord il avait consenti à travailler un dimanche, ce qui est, pour un insulaire, le dernier mot de l’impiété, et qu’il avait consenti ensuite à crocheter, pour faire main-basse sur des papiers anarchistes, la porte d’un Français, M. Delbecque. Malheureusement pour M. Houillier, c’était bel et bien une violation de domicile qu’il allait commet tre sans même y prendre garde, et un délit que les lois anglaises punissent facilement de 150.000 francs d’amende et de cinq ans de penal-servitude.
On comprend que, dans ces conditions, M. Houillier ait repris le premier bateau en partance. Il n’aura réussi démontrer, une fois de plus, la malchance et les maladresses de la Préfecture dans les affaires de police politique.
Au contraire, les recherches de la Sûreté générale semblent avoir été conduites avec une tout autre activité et, dans tous les cas, avec plus de bonheur. C’est grâce à elle, il faut bien en convenir, que l’on sait aujourd’hui quelque chose sur l’explosion du restaurant Véry; le mérite en revient à l’un des trois Spéciaux de la rue Cambacérès, à M. Escourrou, qui, des trois, passe in contestablement pour être le plus habile.
Je me suis laissé conter que M. Escourrou avait eu l’intelligence de se lier avec un anarchiste de très haute marque et dont les anarchistes ne se défieront probablement jamais, tant son passé est déplorable. Un vrai type, ce compagnon ! Il paraît que depuis longtemps il tient une comptabilité régulière des faits et gestes de ses camarades et que, sur chacun d’eux, il possède des dossiers dressés et classés avec une méthode que lui envierait M. Wilson.
On juge si un pareil « indicateur » est un homme précieux. Grâce à ses révélations, M. Escourrou put s’assurer que Drouhet était le véritable détenteur de la dynamite volée à Soisy-sous-Etiolles. De là à s’assurer de Drouhet, il n’y avait qu’un pas. Arrêté et mis au secret, Drouhet ne tarda guère à « manger le morceau », comme on dit et à raconter par le menu tous les détails de l’explosion Véry.
On apprit de la sorte que Meunier, Bricou et sa femme étaient les véritables auteurs de l’attentat.
Mais quand il s’agit de mettre la main sur Bricou et sa femme, ce fut une autre affaire. Il fallut que Bricou, soupçonné de trahison par les anarchistes, essayât, pour échapper à leurs menaces, de se suicider au Havre. Sa femme, elle, se cachait à Paris, mais lorsqu’on voulut retrouver son ancienne adresse… la Préfecture l’avait perdue. Il fallut que M. Lozé vînt la redemander à la Sûreté générale! Finalement, la femme. Bricou, incarcérée à son tour, compléta les bavardages de Drouhet, en dénonçant Francis comme son complice, et c’est ainsi qu’aujourd’hui le Parquet est parfaitement au courant des moindres incidents de la dernière explosion.
Voilà, très authentiquement racontée, la genèse de cette découverte. Il serait, on le voit, difficile d’en attribuer le mérite à la police criminelle de la Préfecture et de refuser ce même mérite à la police politique de la place Beauvau.
Cela ne démontre-t-il pas surabondamment que la police politique est et doit être une police à part? Or, cette police politique proprement dite existe au ministère de l’intérieur ; il suffirait, pour la rendre absolument efficace, d’étendre jusqu’à Paris la juridiction des commissaires spéciaux qui se trouve actuellement limitée à l’intérieur des gares. Dans tous les cas, il paraît démontré que la police politique et la police criminelle gagneraient l’une et l’autre à ne plus être confondues. La première devrait être exclusivement confiée aux Spéciaux, attachés ad latus à la personne même du ministre de l’intérieur ; la seconde devrait être exclusivement laissée aux soins de la Préfecture. Je crois pouvoir affirmer qu’à la Préfecture on serait loin de s’en plaindre. Ce qu’il y a de certain, c’est que les anarchistes sont les seuls à bénéficier de l’organisation actuelle, de ses lacunes et de ses travers.
X.
Le Figaro 22 juillet 1892